L’équipe de recherche ACADISCRI (visant à mesurer et analyser systématiquement l’expérience des discriminations vécue à la fois par les étudiant·e·s et par les personnels de l’ESR) est composée de Tana Bao, Romane Blassel, Géraldine Bozec, Marguerite Cognet, Fabrice Dhume, Camille Gillet, Abdellali Hajjat, Christelle Hamel, Hanane Karimi, Cécile Rodrigues, Pierre-Olivier Weiss.
Le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) en France commence aujourd’hui à être bien analysé sous l’angle des inégalités sociales et de leur évolution en général. Il l’est sensiblement moins sous l’angle des discriminations – problématique qui fait l’objet d’une reconnaissance institutionnelle ambiguë, et d’une évaluation scientifique encore balbutiante. Reconnaissance politique, connaissance scientifique et action publique sont ainsi à construire simultanément sur une question majeure, mais restée jusqu’ici en déshérence.
Sortir du flou, nommer le problème
Politiquement, la question des discriminations dans l’enseignement supérieur fait l’objet d’une lente reconnaissance. En 1998, la nouvelle « priorité de l’État » de lutter contre la discrimination raciale, initiée par la gauche, n’a pas semblé concerner l’ESR. Après le retour aux affaires de la droite, en 2002, la question s’efface progressivement au profit du thème de « l’égalité des chances », réduit aux dispositifs élitistes pour l’accès aux grandes écoles. Puis en 2008, c’est sous le mot d’ordre de la « diversité » que le rapport commandé par le ministère à Michel Wieviorka réintroduit cette question. Ce rapport pointe les « discriminations systémiques et les mécanismes qui s’en rapprochent », tout en posant, sans plus d’enquête (puisqu’à cette date il n’existe pas de travaux scientifiques sur cette question en France), que le « racisme concret » aurait lieu principalement « autour » des études (accès à l’emploi, logement…).
En janvier 2015, en réponse aux attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher, en même temps qu’elle traduit l’engagement flou du Président François Hollande de faire « de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme une grande cause nationale » (décembre 2014), la « Grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République » annonce l’objectif de « mieux former les enseignants du supérieur aux enjeux de laïcité, de lutte contre les discriminations, le racisme et l’antisémitisme ».
Dans les annonces du 22 janvier 2015, le ministère de l’Éducation nationale, de la recherche et de l’innovation prévoit la création de référents « laïcité » à l’école, et de référents « racisme et antisémitisme » à l’université. Si l’Observatoire de la laïcité préconise en décembre 2015 la « l’instauration d’un référent laïcité dans chaque université », c’est finalement la seconde terminologie qui s’imposera dans l’enseignement supérieur et la recherche. Cet objectif est réaffirmé en mars 2018 par le Premier ministre dans la présentation de son plan de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.
D’un autre côté, la préoccupation gouvernementale pour l’égalité professionnelle dans la fonction publique croît au cours des années 2000. En témoigne l’adoption d’un nouveau référentiel d’action publique, l’approche intégrée du genre, qui mène à la plus grande diffusion de données chiffrées pour documenter les situations inégalitaires entre les femmes et les hommes, ou encore à la création de « missions » chargées des droits des femmes dans diverses institutions. Suite aux premiers engagements de la Conférence des présidents d’universités (aujourd’hui France Universités) en 2009, la loi de 2013 impose aux universités la nomination d’une personne en charge des questions d’égalité, en lien avec un objectif d’exemplarité des employeurs publics. Rapidement, la question des violences sexistes et sexuelles entre dans l’agenda des chargé·e·s de mission, et de premières initiatives voient le jour.
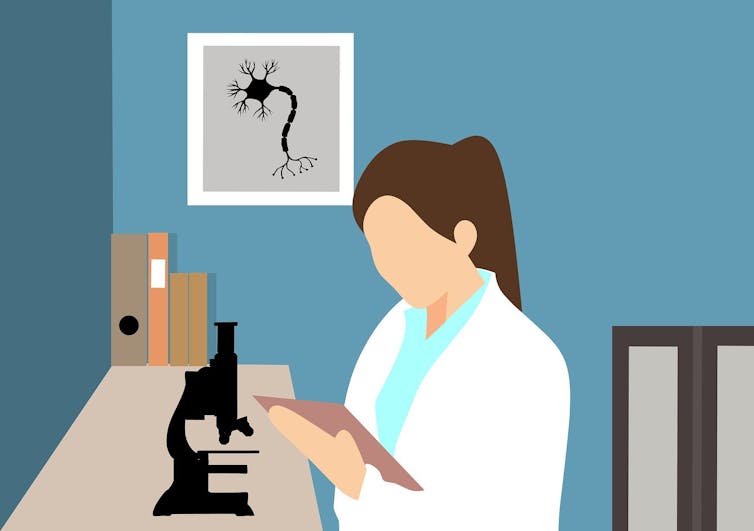
En 2017, le mouvement #MeToo redonne de la visibilité à cette problématique des violences sexistes et sexuelles dans l’ESR et, dans le sillage de ce mouvement émerge l’Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes, qui publie son premier rapport en 2020. Vingt ans après la naissance du Collectif de lutte contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur, la mise en place des cellules d’accueil et d’écoute pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles est annoncée. Quant au « Plan de lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT+ dans l’ESR » (2019), il débouche sur un « Guide pour lutter contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ ».
« Laïcité », « violences sexistes et sexuelles », « racisme et antisémitisme », « haine », ou encore « politique d’inclusion » concernant le handicap, autant de problématisations institutionnelles distinctes et dont le lien avec les discriminations n’est pas mis en avant… malgré un discours ministériel valorisant une « politique résolue dans la lutte contre toutes les formes de discrimination ». L’émergence d’un discours ministériel sur le thème des discriminations, dans l’ESR, ne s’est donc pas accompagnée d’une problématisation. Elle ne s’est en outre pas traduite par une augmentation significative des connaissances, au point qu’à bien des égards nous avons affaire à une action publique sans problème public.
Sortir des cloisonnements, comprendre les articulations
Dans l’ESR en particulier, les discriminations représentent une réalité largement sous-estimée, du fait d’une recherche fragmentaire et dispersée. La connaissance sur l’expérience du sexisme à l’université a certes sensiblement progressé ces dernières années, à la faveur d’enquêtes telles que Virage-Universités. Mais les différents rapports sociaux sont inégalement considérés : les discriminations raciales sont nettement moins documentées – comme l’a montré le colloque « Racisme et discrimination raciale, de l’école à l’université », à Paris Diderot en septembre 2018 – de même que les discriminations LGBTphobes ou validistes.
Plus encore que la recherche, l’action publique (re)produit des cloisonnements et des hiérarchisations. Les politiques sont historiquement construites en « silos » : l’« égalité femmes/hommes » et des actions sur les « violences sexistes et sexuelles » côtoient sans les rencontrer des « relais handicap », auxquels s’ajoutent des « référent·e·s racisme et antisémitisme ». La loi de transformation de la fonction publique de 2019 oblige certes les institutions sous tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à élaborer et à mettre en œuvre un plan d’action pluriannuel relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et mentionne également la « lutte contre les discriminations », la « diversité » et le « handicap ». Toutefois le principe d’unification par les plans d’action peut n’être qu’un exercice de communication prolongeant l’absence d’articulation des causes et de problématisation transversale, notamment en termes de discrimination.
Comme l’a constaté la Commission permanente des chargés de mission Égalité (CPED), si certains établissements ont développé des « missions égalité-diversité » à vocation transversale, « peu d’établissements ont nommé des personnes chargées des discriminations » (Kit de prévention des discriminations dans l’enseignement supérieur, décembre 2021, p. 11). Plus fondamentalement, le principe de traiter le problème par l’instauration de « missions » surtout symboliques pose la question des moyens réels d’action, au risque de n’être, comme pour le racisme, qu’un « cosmétique ministériel ».
Par ailleurs, la question des inégalités socio-économiques est toujours traitée sur un autre plan et n’est guère articulée avec les autres systèmes de domination ni abordée sous l’angle des discriminations. Cette situation maintient une concurrence de fait entre les diverses causes et alimente la croyance que, si les inégalités sociales relèvent d’enjeux de redistribution économique et matérielle, les autres inégalités (de genre, d’ethnicité…) relèveraient surtout d’enjeux de reconnaissance identitaire et symbolique. La problématique des discriminations est pourtant à un point de nouage entre ces deux niveaux d’enjeux : en s’attachant à la dimension matérielle des inégalités de traitement, elle montre des mécanismes – directs et indirects, individuels et systémiques – qui produisent tout à la fois des inégalités articulées (socio-ethno-genrées par exemple) et des effets politico-symboliques (altérisation, minorisation).

On peut en ce sens souligner l’effort de l’Observatoire national de la vie étudiante (OVE) de prendre de plus en plus en compte, dans ses enquêtes sur les conditions de vie, la perception des discriminations. Il faut également saluer la sortie récente de plusieurs études, attestant de l’expérience multiple des discriminations vécues par les étudiant·e·s, ou des discriminations dans la sélection à l’entrée en formation. Toutefois, on peut regretter que l’approche du phénomène, focalisée sur les étudiant·e·s, laisse dans le même temps dans l’ombre la manière dont la discrimination traverse et structure les rapports de travail au sein de l’ESR, ce qui risque de reproduire une coupure entre personnels et publics des universités, entre lieu d’étude et lieu de travail.
Enjeux simultanés de connaissance, de reconnaissance et d’action
Dans ce contexte d’insuffisante connaissance des enjeux, les établissements de l’ESR sont l’objet depuis quelques années d’une pression croissante pour réaliser des diagnostics en matière d’inégalités. Certains ont devancé ces obligations ministérielles comme l’a souligné ici Pascal Tisserant, et, mobilisant les ressources internes de recherche, se sont saisis de l’occasion pour mener des études visant à évaluer la perception ou le vécu des discriminations. D’autres établissements répondent à l’injonction en commandant à des cabinets de consultants ou à des instituts de sondage des enquêtes à la rigueur scientifique douteuse (notamment sans aucun contrôle des répondants ni pondération des résultats).
De leur côté, les associations et syndicats étudiants multiplient les initiatives d’enquêtes sur le vécu des usagères et des usagers (et parfois des personnels) des universités, d’appel à témoignage ou de documentaires. Ils montrent ainsi le besoin de connaissance en la matière, mais également le fait qu’ils n’ont pas attendu les chercheuses et chercheurs pour faire progresser à leur échelle la (re)connaissance du problème. On peut citer, pour illustration, le sondage commandité par l’Union des étudiants juifs de France sur « Le regard des étudiants juifs sur l’antisémitisme » (2019), l’enquête de l’Union Nationale des Étudiant·e·s de France (UNEF) portant sur « les discriminations dans l’enseignement supérieur » (2020), le baromètre du Caélif Étudiant·e·s LGBT sur les « LGBT-phobies dans l’enseignement supérieur en France » (2020). Ou encore le projet de documentaire « Briser le silence des amphis » visant à « donner encore plus d’écho à celles et ceux qui dénoncent ces violences, et permettre une large discussion ». Sur les réseaux sociaux, de nombreux collectifs d’étudiants proposent aussi des appels à témoignages.
(Faire) parler (de) l’expérience des discriminations est ainsi autant un levier pour constituer un problème public qu’une manière d’articuler connaissance et reconnaissance du problème. Comme l’ont montré d’autres grandes enquêtes nationales (telles Trajectoires et origines [TeO] ou Violences et rapports de genre [Virage]), c’est en même temps un moyen pour analyser la manière dont fonctionnent des systèmes oppressifs et dont ils s’incrustent dans les institutions éducatives ou dans les milieux de travail.
C’est dans cette perspective que nous avons lancé l’enquête ACADISCRI. Son objectif est de mesurer et d’analyser systématiquement l’expérience des discriminations vécue à la fois par les étudiant·e·s et par les personnels de l’ESR. Elle propose des résultats pondérés, représentatifs des populations des établissements participants. L’enquête prend en compte simultanément, et de façon croisée, les grands rapports sociaux (sexe, ethnicité, orientation sexuelle et identité de genre, classe sociale, handicap et état de santé…), et ambitionne de pouvoir mieux comprendre l’articulation entre ces différents systèmes de domination.

Romane Blassel, Post-doctorante, Université Côte d’Azur; Camille Gillet, Doctorante en sociologie, Sorbonne Université; Fabrice Dhume, Sociologue indépendant, associé à l'URMIS, affilié à l'IC Migrations, Université Paris Cité; Pierre-Olivier Weiss, Post-doctorant en sociologie, Université Côte d’Azur et Tana Bao, Post-doctorante pour Acadiscri rattachée à l'Urmis, Université Côte d’Azur
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.





